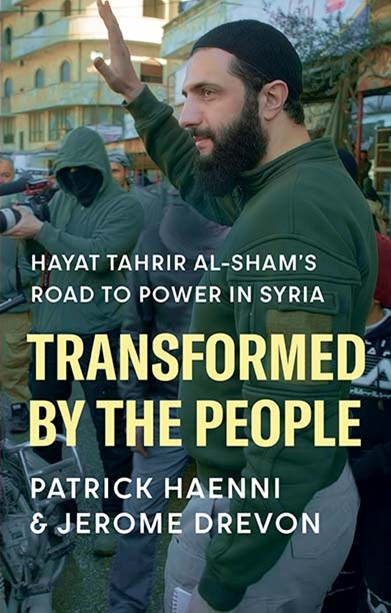
Religioscope — Comment ce projet a-t-il émergé ? Qu’est-ce qui, à un moment donné, a fait basculer une accumulation d’observations en un objet intellectuel, puis en un livre ?
Patrick Haenni — Je crois que ce livre naît à la confluence de deux opportunités, deux fenêtres qui se sont ouvertes en même temps, et qui ont convergé pour rendre possible un travail assez rare sur un mouvement comme HTS.
La première opportunité, c’est celle du terrain. C’est la possibilité — sur la durée, et avec une continuité peu fréquente dans ce type de contexte — de développer une relation relativement proche avec le milieu où HTS s’est implanté comme groupe hégémonique à partir de 2019. Nous fréquentions la région d’Idlib, et plus largement les zones de l’opposition, depuis 2013. Mais la rupture qualitative se produit en 2019 : à l’occasion d’un premier contact avec le leadership du mouvement, un accès s’ouvre — fragile, négocié, jamais acquis, mais réel — et nous n’avons ensuite plus interrompu ce suivi. Concrètement, cela veut dire un rythme de présence et d’observation soutenu : un voyage tous les deux ou trois mois, avec, à chaque fois, une attention portée à la fois aux dirigeants du mouvement et aux « bases » sur lesquelles ce dernier s’appuie.

D’un côté, il y a les contacts « par le haut » : les discussions avec le leadership, les cadres, les responsables des institutions émergentes, les acteurs qui fabriquent une ligne politique et la mettent en récit. De l’autre, il y a l’engagement avec la société dans son ensemble : les opposants ordinaires, les femmes, les leaders religieux, les acteurs civils, la diaspora de l’opposition syrienne en Turquie qui décrit et interprète l’expérience d’Idlib, et aussi les individus qui, sans être des cadres, sont des médiateurs, c’est-à-dire ceux qui traduisent une norme, négocient un conflit local, organisent un arrangement pragmatique entre un appareil de domination et une société qui ne se laisse jamais totalement absorber.
Cette double entrée — par le haut et par le bas — nous a donné une matière dense, stratifiée et « unique », dans la mesure où les accès au leadership étaient rares, voire exceptionnels avant 2019. Avant notre première rencontre avec Ahmed al-Shara (Abou Mohammad al-Joulani de son nom de guerre), les entretiens qu’il avait accordés se comptaient sur les doigts d’une main et uniquement destinés à des médias arabes. Cela situait notre travail dans un espace particulier : ni complaisance, ni fantasme, mais un effort pour comprendre à partir d’un suivi réel, régulier, et donc comparatif dans le temps.
La deuxième opportunité, elle, tient à la dynamique propre du mouvement et à l’image qu’il voulait projeter vers l’extérieur. Si HTS acceptait de discuter, ce n’était évidemment pas par pur goût du dialogue. Leur démarche comportait une dimension de communication : ils savaient qu’un échange avec des chercheurs occidentaux pouvait servir de vecteur pour certains messages à destination d’acteurs politiques extérieurs à la Syrie. Ils cherchaient à signaliser qui ils sont et voulaient être, disons, recatégorisés.
Ce que nous avons rapidement observé, c’est un modèle de mouvement islamiste qui, tout en héritant d’un passé marqué par des structures et des imaginaires issus d’al-Qaïda, cherche à se repositionner hors de ce cadre, sans posséder pour autant une boussole idéologique claire pour accomplir ce déplacement. C’est là que, sur le plan intellectuel, le phénomène devient fascinant : on a l’impression d’assister à une forme de « déradicalisation », mais une déradicalisation atypique, qui ne prend pas les chemins attendus, canonisés dans la littérature sur les itinéraires des mouvements islamistes.
Classiquement, lorsqu’on parle de déradicalisation de mouvements armés islamistes, on pense à des révisions doctrinales explicites : des textes, des « murâjaʿât », des autocritiques théologiques, des révisions de la légitimité de la violence. Or, ici, on voit autre chose : une déradicalisation qui passe d’abord par le politique, par les contraintes de gouvernement, par l’organisation du quotidien, par l’obligation de faire tenir un ordre social, et par la nécessité de recomposer des alliances locales et d’aspirer à des alliances internationales. Autrement dit, une déradicalisation par la pratique, avec une bonne part d’improvisation, sans grands cadres théoriques et parfois même sans discours cohérent.
Et nous avons eu le privilège de pouvoir observer cette trajectoire sur plusieurs années : depuis le moment où HTS prend le contrôle absolu d’Idlib en 2019, s’impose comme acteur hégémonique, et entre dans l’expérience de la gouvernance, jusqu’aux transformations ultérieures. Ce qui nous importait, ce n’était pas seulement de décrire un groupe « à un instant T », mais de comprendre une trajectoire, une dynamique. Ce suivi au long cours nous a permis de regarder non seulement les pratiques, mais aussi la manière dont ces pratiques étaient conceptualisées par ceux qui, progressivement, allaient devenir des acteurs centraux du paysage politique syrien post-Assad — surtout après la chute du régime en décembre 2024.
Sortir de la « jihadologie »
C’est là que naît votre réflexion sur l’approche à adopter. Vous me disiez, lors de notre conversation préparatoire, que vous vouliez sortir d’une lecture jihadologique pour adopter une perspective davantage centrée sur le mouvement HTS comme fait social, politique et révolutionnaire. Pourriez-vous développer ce déplacement de focale ?
PH — Une des constantes de nos échanges avec eux était des discussions qu’on peut qualifier d’ontologiques. Des discussions sur la question : qui êtes-vous ? Et donc, par miroir, comment vous définissez-vous ? Comment vous situez-vous sur le spectre des organisations liées à l’islam politique, à l’islam militant, au jihadisme, etc. ?
Or, ce que nous observions, c’est une difficulté réelle de leur part à se définir positivement. Le leadership clarifiait surtout des points de départ, des positions de rupture : ce qu’ils laissaient derrière eux, ce qu’ils n’étaient plus, ce qu’ils refusaient d’être. En revanche, exprimer une identité stable et proposer un récit idéologique cohérent s’avérait un exercice beaucoup plus compliqué.
À mon sens, c’est là que l’approche strictement « jihadologique » montre ses limites. La jihadologie a tendance à classer les groupes dans des catégories et des dynamiques relativement figées : salafisme-jihadisme, jihad global vs local, islam politique, continuité doctrinale, etc. Or, HTS donnait à voir un objet plus instable et fluide : une organisation qui se transforme par l’expérience politique, par interaction avec son environnement local et international, par ajustements successifs — parfois incohérents au moment où ils se produisent — mais qui, cumulés, fabriquent une autre réalité. Et surtout lui confèrent progressivement une cohérence.

Illustrons ce propos en comparant la stratégie d’HTS avec celle des Frères musulmans. Ces derniers sont inscrits dans une logique d’ancrage social large : des mouvements de masse, relativement intégrés à la société, souvent portés par des segments issus de la classe moyenne, et structurés autour d’une idée d’encadrement total — la shumûliyya — qui construit des organisations parallèles (jeunesse, sport, associations, femmes, réseaux caritatifs, etc.), comme le faisaient, par exemple, les mouvements communistes du début du XXe siècle. Les Frères sont surtout et avant tout réformistes : la conquête du pouvoir est pensée comme un processus « du bas vers le haut ». On réforme la société d’abord ; l’État tombe ensuite « comme un fruit mûr » une fois que la société est prête.
HTS n’est pas dans cette perspective. Ce n’est pas un mouvement de masse. C’est un mouvement plutôt élitiste qui s’inscrit dans une logique d’avant-garde. D’un point de vue organisationnel, HTS ressemble à certains égards aux mouvements de type « léninistes » : discipline, clandestinité, méfiance, centralisation. HTS voulait soutenir la révolution, mais fonctionnait de facto avec une grande défiance envers les autres acteurs. Il partageait peu, gardait le contrôle, cherchant l’hégémonie, et s’inscrivait d’abord dans une confrontation armée avec l’État.
Pour HTS, l’ancrage social n’est pas le point de départ ; il est un produit de l’échec relatif de la prise directe du centre, de Damas. Quand la victoire rapide est impossible, l’implantation territoriale devient nécessaire, exige une politique, et la gouvernance devient porteuse de contraintes ; la territorialisation, c’est la porte d’entrée d’une expérience thermidorienne, la fin de la pureté des origines, le renoncement à la tabula rasa, l’apprentissage de la conciliation et des compromis — y compris avec le dogme.
D’ailleurs, les relations avec les Frères musulmans syriens sont marquées par la méfiance réciproque. Les Frères, comme la majorité des acteurs évoluant dans le spectre de l’opposition, perçoivent HTS comme un concurrent, et comme un acteur « problématique » en raison du label terroriste qui pèse sur l’organisation et sur une partie de son leadership. HTS, de son côté, se méfie des Frères pour de multiples raisons : compétition politique, soupçon d’opportunisme, et aussi, très vite, la réalisation que l’étiquette « frères musulmans » est, dans les rapports internationaux, extrêmement toxique. Joulani l’avait saisi assez tôt : mieux vaut s’en détacher que s’y référer.
Salafisme, jihadisme : catégories utiles ou pièges analytiques ?
Vous exprimez également des réserves quant à l’application non qualifiée du label « salafiste » à HTS.
PH — Oui. Le réflexe de beaucoup d’analystes consiste à essayer de faire entrer un mouvement armé islamiste tel qu’HTS dans le moule « salafiste-jihadiste », c’est-à-dire un groupe paramilitaire rehaussé d’une idéologie de purification religieuse et d’un rapport spécifique à la société. Mais ce couplage est historiquement récent — et surtout, il n’est pas ici nécessaire. Il y a du salafisme sans jihadisme ; il y a du jihadisme sans salafisme.
Si l’on définit le salafisme par son objectif premier — la réforme de la société, la purification du dogme et de la pratique religieuse, et une interrogation sur l’ordre politique à partir de cette purification — alors HTS ne rentre tout simplement pas dans cette case. À partir de 2019, une fois au pouvoir à Idlib, la priorité n’a pas été de « remettre la société sur le droit chemin » par une entreprise systématique de purification du dogme et des pratiques religieuses. En premier lieu, ils n’en avaient pas les moyens. HTS n’est pas un mouvement de masse capable de mobiliser des milliers de prédicateurs et de cadres religieux pour remplacer une infrastructure cléricale existante. Ensuite, sur le plan politique, son leadership ne voulait pas antagoniser la société. HTS avait besoin d’un corps social qui, au minimum, ne se soulève pas contre eux — et, idéalement, soutienne l’effort militaire contre le régime. Enfin, et c’est un point crucial, HTS n’était pas très intéressé par une réforme doctrinale de la société envisagée comme une fin en soi. Son horizon restait avant tout celui de la guerre et de la survie, puis celui de la gouvernance comme gestion de contraintes et, in fine, comme exercice du pouvoir. Gouverner, c’est travailler avec ce qui existe. Or, Idlib est une société traversée par des formes d’« islam populaire », une expression imparfaite qui recouvre une grande diversité de pratiques et de sensibilités. Certains imams adoptent une position rigoriste proche d’un salafisme militant, tandis que d’autres s’inscrivent dans des courants soufis. Beaucoup se situent dans un conservatisme religieux ordinaire, fortement ancré dans une tradition juridique locale chaféite, qui cohabite souvent avec des formes de piété populaire et même avec le soufisme. Cette tradition chaféite est de surcroît doctrinalement, relativement éloignée du hanbalisme, l’école de jurisprudence présentant les affinités les plus fortes avec le credo salafiste.
Donc, pour le dire simplement, ils composent avec une pluralité de référents et de normes, sans imposer une orientation doctrinale unique.
PH — Exactement. Et cet exercice n’est pas le résultat d’un relativisme doctrinal, mais celui d’un impératif politique. Quand on contrôle un territoire, on se retrouve inévitablement confronté à des questions très concrètes. Prenons l’exemple des mosquées : il y en a environ 1200 sur ce territoire. Quelle option s’offrait à HTS ? Remplacer l’ensemble des imams et des prédicateurs du vendredi ? Une telle ambition aurait été impossible, et ce, pour trois raisons.
Premièrement, le manque de ressources humaines : ils ne disposaient tout simplement pas d’un nombre suffisant de cadres pour occuper tous les postes. Deuxièmement, le risque politique : écarter brutalement un clergé local, souvent enraciné dans les communautés, aurait exposé le mouvement à une conflictualité sociale majeure. Troisièmement, l’absence de volonté stratégique : une telle réforme ne faisait pas partie de leurs priorités.
Donc, si l’on considère que le salafisme se définit par la centralité de la purification doctrinale (tanqiyat al-muʿtaqad), et par une volonté structurée d’ingénierie religieuse sur la société, alors ce pilier n’est pas au cœur de leur pratique. Ils peuvent enseigner certains préceptes qu’on qualifierait de salafistes, notamment sur le credo théologique (ʿaqîda), mais leur rapport à la société et leur rapport au politique ne sont pas salafistes au sens fort.
Qu’en est-il de la dimension jihadiste d’HTS ?
PH — Ils combattent par les armes, évidemment. Mais à ce compte-là, toutes les factions de l’opposition armée sont « jihadistes » au sens littéral : elles pratiquent le jihad comme combat. La question est : de quel jihad parle-t-on ? D’un jihad global, structuré par une idéologie transnationale et une centralité de l’ennemi lointain ? Ou d’un jihad local, inséré dans une dynamique territoriale et politique et avant tout centré sur l’objectif de la chute du régime plus que sur l’application d’une doctrine dûment élaborée du pouvoir et de l’État ?
Après la rupture organisationnelle avec al-Qaïda en 2016, ils ont, pour des raisons de contrôle, réduit l’influence des idéologues du jihad global. Ils ont pris leurs distances avec des figures de référence, et ils ont cherché à couper les ponts non seulement sur le plan organisationnel, mais aussi idéologique. Donc oui, ce sont des combattants qui mobilisent un registre religieux, mais cette caractéristique les distingue finalement assez peu de beaucoup d’autres acteurs armés dans un contexte de guerre civile où la grammaire religieuse sert de langage commun à des pratiques très variées.
Au total, ce que l’on observe, c’est qu’il est relativement facile de définir ce qu’ils ne sont pas — ou ce qu’ils ne veulent plus être — et beaucoup plus difficile de les faire entrer dans les catégories disponibles de la « jihadologie ». Dans notre livre, nous avons voulu éviter deux tentations : d’une part, inventer une étiquette ad hoc, un néo ou post-quelque chose, qui donnerait l’illusion d’une capture conceptuelle du mouvement alors qu’elle masquerait sa complexité ; d’autre part, enfermer leur trajectoire dans un univers comparatif exclusivement islamiste ou jihadiste.
Nous avons donc fait le choix d’un biais comparatif volontairement provocateur, mais à nos yeux plus heuristique : sortir du seul champ de l’islamisme pour interroger des trajectoires analogues ailleurs. La question devient alors la suivante : quels autres mouvements radicaux, dans des contextes politiques et culturels différents, ont opéré un recentrage idéologique — un passage du bord radical vers une posture plus centriste — sans pour autant passer par une transformation doctrinale profonde ? Et là, une partie des éléments de réponse se trouve, peut-être contre-intuitivement, du côté de certaines droites identitaires en Europe et plus largement en Occident. On y observe des processus de normalisation, de « passage au mainstream », où l’idéologie se reconfigure, non pas par révision doctrinale ou renoncement explicite aux fondements idéologiques initiaux, mais par ajustement aux contraintes de la compétition électorale, à l’opinion publique, aux exigences de la gouvernance et aux rapports de forces internationaux.
L’objet au cœur du livre, c’est la manière dont un mouvement situé dans les marges radicales d’un champ politique tente de se rapprocher du centre. Comment avez-vous conceptualisé ce processus ?
PH — Nous avons travaillé autour de l’idée d’un passage au mainstream qui n’a pas vraiment d’équivalent clair dans le champ des mouvements islamistes armés. Bien sûr, il existe des déradicalisations individuelles « par le bas ». Il existe aussi des trajectoires collectives « par le haut », notamment en prison, où des idéologues produisent des textes de révisions doctrinales — comme le Jihad Islamique en Égypte avec les murâjaʿât. Cependant, HTS n’a jamais fait ce type de révision idéologique explicite : pas de grand texte fondateur, pas d’aggiornamento doctrinal officiel, pas de charte. Et, point crucial, on ne voit pas non plus, à ce stade, la formulation d’une doctrine nouvelle qui aurait « accouché » de cette transformation. En réalité, la vraie question aujourd’hui c’est exactement l’inverse : dans quelle mesure cette transformation discrète peut à terme produire une nouvelle posture idéologique claire et assumée, ce qui, avec la prise de l’État, se révélera à un moment nécessaire.
Pour penser ce phénomène, nous avons donc déplacé l’analyse : plutôt qu’une grille islamologique ou jihadologique, nous avons adopté une perspective de sociologie politique, et, plus précisément, une sociologie des révolutions pour désigner une configuration paradoxale : un mouvement qui a été révolutionnaire, radical, parfois terroriste, et qui, confronté à l’exercice de la gouvernance, cherche un recentrage pragmatique — non pas vers un libéralisme politique, mais vers une forme de centrisme gestionnaire, « normalisé », c’est-à-dire ajusté aux normes et visions du monde socio-religieuses de leur environnement d’implantation : la société musulmane sunnite conservatrice d’Idlib. Ainsi, ce n’est pas un hasard si l’un des ministres influents du gouvernement nous disait, un an après la prise de pouvoir, que ce qu’ils cherchent, c’est la normalité régionale ou, selon ses termes, devenir un « État normal comme ses voisins », la Jordanie, la Turquie et l’Arabie Saoudite dans sa dernière mouture.
L’idée est simple : un mouvement profondément révolutionnaire, qui veut renverser l’ordre politique, peut être amené à sortir d’une phase de terreur, ou d’exception, pour entrer dans une phase où le politique devient la priorité. Et il se pense — contrairement à l’État Islamique — comme obligé d’interagir avec les contraintes inhérentes à l’exercice du pouvoir, d’y répondre, de négocier avec elles. Ce déplacement transforme les pratiques, puis les équilibres internes, puis enfin les identités.

Les fils argumentatifs du livre
Pouvez-vous nous présenter la structure argumentative du livre ? Quels sont les axes principaux qui organisent votre démonstration ?
PH — Le premier, c’est l’idée d’une révolution silencieuse : HTS s’est profondément transformé — une transformation interne, une « révolution sur soi-même » — mais sans produire le discours qui, habituellement, accompagne une révolution idéologique. Le leadership a du mal à dire qui il est. Les discussions autour de son identité clarifient surtout ce qu’ils rejettent, pas ce qu’ils proposent. Et, surtout, la transformation ne s’est pas faite par révision doctrinale. Elle ne s’est pas annoncée par une doctrine nouvelle, et elle n’a pas non plus, jusqu’ici, produit une doctrine stabilisée après coup. Donc, première leçon : la déradicalisation ne passe pas forcément par une révision théologique ou idéologique explicite.
Le deuxième axe, c’est la synergie positive entre relocalisation et déradicalisation. HTS est issu d’un ancrage clair dans le jihad global : Irak, confrontation avec les États-Unis, puis intégration à l’univers d’al-Qaïda. La rupture de 2016 a souvent été débattue entre l’accusation d’un camouflage stratégique ou la reconnaissance d’une rupture sincère avec cet héritage. La question est pertinente, mais nous pensons qu’elle a été posée de manière trop négative : on a vu la rupture comme une soustraction, un lien coupé. Or, ce qui nous intéresse, c’est l’autre face : la rupture du global va avec un réengagement dans le local. La relocalisation, c’est la prise au sérieux des normes, des contraintes, des attentes d’une société territorialisée. C’est l’acceptation que l’environnement social n’est pas un matériau entièrement malléable. Et c’est précisément ce que signifie notre titre Transformed by the people — transformé par la société, par ses inerties, par ses résistances, par ses cadres de sens. Et cette inertie déradicalise.
Et là, un choix est décisif : soit on gouverne par pure coercition, selon le modèle adopté par l’État Islamique, soit on s’accommode, on négocie, on compose. HTS choisit la seconde voie, pour des raisons stratégiques : il lui faut une base sociale, ou au minimum une société qui ne conteste pas frontalement sa domination, afin de poursuivre la confrontation avec le régime.
C’est ici que l’on voit la force de l’inertie du social : quand on ne peut pas remplacer 1200 imams, on accepte la pluralité existante. Et cette pluralité religieuse devient un élément structurant de la gouvernance.
Cette relocalisation a aussi un effet de déradicalisation en interne : pour rompre avec les idéologues du jihad global, il faut se réancrer dans des traditions locales. D’où l’importance des écoles de jurisprudence : sortir d’un rejet salafiste de ces écoles (la-madhhabiyya), et se réinscrire dans l’école chaféite dominante. C’est, à la fois, une stratégie de rupture idéologique et une stratégie de légitimation locale.
Le troisième axe consiste à doter la notion de déradicalisation d’un contenu véritablement opératoire. Nous la définissons comme l’effet cumulatif de compromis idéologiques successifs qui déplacent un mouvement d’une position radicale vers une position plus centrée sur les canons politico-religieux de l’espace social où il évolue. Ce recentrage ne saurait toutefois être confondu avec une « modération » : il renvoie à une logique d’alignement stratégique sur la majorité silencieuse d’un contexte donné — ici Idlib, espace majoritairement sunnite et conservateur —, sur ses normes sociales et plus particulièrement sur ses cadres de perception du religieux. Cette définition est importante parce qu’elle évite de réduire la déradicalisation à un texte ou à une confession doctrinale. Elle permet de voir une dynamique à l’œuvre dans les pratiques : compromis après compromis, décision après décision, jusqu’à produire un déplacement durable — et sans doute irréversible — du curseur idéologique du mouvement.
Une partie de ces compromis provient du rapport à la société : si l’on ne veut pas antagoniser une société majoritairement non radicale, on est poussé vers le centre. Mais une autre partie — décisive — vient du rapport à l’international. À partir de 2018, la dynamique militaire est défavorable à l’opposition. La Turquie intervient d’abord pour freiner l’avancée du régime, puis s’engage directement en 2020. HTS doit accepter la présence turque sur son territoire. Pour une fraction nourrie à l’idéologie du jihad global, c’est un tabou : accepter une armée issue d’un État séculier, que certains qualifiaient alors d’« armée athée », semblait inconcevable. Le débat interne s’ouvre : peut-on s’appuyer sur des forces « infidèles » ? Bien qu’une frange du mouvement réponde par la négative, la contrainte stratégique va finalement l’emporter.
Puis viennent d’autres opportunités de compromis : coopérer avec l’ONU pour l’acheminement de l’aide — vitale pour une population massive. Et, inévitablement, poser la question du label terroriste. Dès nos premières rencontres à Idlib, Joulani formule une ligne stratégique d’adresse à l’Occident, laquelle, en substance, reconnaît que nous avons des ennemis communs (Iran, Russie, régime), et qu’il est donc nécessaire de trouver une forme d’entente. Chaque étape produit une tension : la contrainte internationale pousse vers une posture plus centriste, mais accroît également le coût politique interne, ce qui suscite défections et répressions occasionnelles, lesquelles élaguent le mouvement de ses éléments les plus durs.
Le quatrième axe s’articule sur l’idée que la somme cumulée de concessions tactiques, par exemple la question des patrouilles mixtes turco-russes dans les zones rebelles après l’accord de 2020, finit par créer un point de non-retour. Ce qui était tactique devient structurel. Les compromis engendrent des effets internes : recomposition des rapports de force, marginalisation des radicaux, clarification progressive de l’identité politique. Autrement dit : une nouvelle ontologie se construit sans être explicitement théorisée.
Pour réduire l’influence du jihad global, HTS adopte des ancrages juridiques : référence chaféite, et recours à des formes de codification « hybrides » de la sharia qui permettent de limiter le pouvoir discrétionnaire des cheikhs les plus radicaux, en encadrant la normativité par des textes.
Quant à l’institutionnalisation, elle sert une stratégie de containment plus que de répression brutale des radicaux. Elle permet d’intégrer des voix problématiques dans des institutions contrôlables, les neutraliser par la forme plutôt que par l’exclusion immédiate. Des organes comme le Conseil de l’Iftâ’ peuvent avoir une fonction publique réduite (fatwas très pratiques centrées sur les rituels et le quotidien), mais une fonction politique interne forte : absorber les radicalités, les discipliner ou les contraindre au silence.
Enfin, un exemple particulièrement révélateur : l’ouverture aux minorités (chrétiens, druzes), pensée en termes de réconciliation, restitution, retour, et encadrement des discours de haine. Là encore, chaque ouverture génère des résistances locales qui obligent HTS à réagir et cette réaction produit à son tour un écrémage constant au sein du mouvement. C’est ce que nous appelons, de manière volontairement simple, le « cercle vertueux » de déradicalisation : plus le groupe s’ouvre au compromis, plus il suscite de contestation ; plus il contrôle ou réprime cette contestation et moins les résistances sont élevées, et moins elles sont élevées, plus le coût du prochain compromis s’en trouve réduit, ce qui, par extension, incite à continuer dans la même direction. Bien sûr, ce processus n’est « vertueux » que dans la mesure où il entraîne une sortie du radicalisme. Il demeure très ambivalent en termes de libertés politiques.

Après Damas : que devient la question du radicalisme ?
Vous aviez le sentiment, à l’été 2024, que cette trajectoire de transformation atteignait un seuil, non pas en direction d’un libéralisme politique, mais plutôt vers une zone grise stabilisée. Votre livre était en grande partie prêt avant la prise de Damas en décembre de cette année.
PH — À l’été 2024, nous avons en effet eu l’impression d’un cycle qui se clôt. HTS avait lâché du lest sur certains de ses principes initiaux, sans pour autant produire une nouvelle boussole idéologique. Ce n’était ni une démocratisation ni une conversion doctrinale. C’était une stabilisation dans une zone grise : gouvernance, contrôle, pragmatisme, recentrage sans discours. Et, effectivement, le livre n’est pas né de la prise de Damas ; il était en grande partie achevé un an avant le grand soir. Ce qui a changé, c’est moins notre désir d’écrire que l’intérêt des éditeurs à le publier.
À présent que HTS est au pouvoir à Damas, et qu’il est devenu, d’une certaine manière, le nouveau régime, que nous dit cette trajectoire de modération par accumulation de décisions tactiques sur la période qui s’ouvre ? Et plus précisément, comment la prise de l’État affecte-t-elle la question du radicalisme ?
PH — Dans la théorie politique jihadiste, il existe une réponse à cette question. Quand un acteur jihadiste est en guerre, il se considère en phase de faiblesse, marḥalat istiḍʿâf, qui lui autorise une certaine latitude, des dérogations, des compromis, une application moins stricte de certains préceptes. La prise de l’État, en revanche, est pensée comme le moment du tamkîn, c’est-à-dire de l’empowerment, la consolidation du pouvoir, censé déclencher le taḥkîm al-sharîʿa, c’est-à-dire l’application par le haut, par l’État et les institutions, de la loi islamique.
Or, la réalité en Syrie semble fonctionner à rebours de la théorie politique jihadiste : le tamkîn, entendu comme la prise de l’État, n’a nullement constitué le moment du déploiement décomplexé d’un projet islamiste enfin libéré de ses contraintes. Il a, au contraire, produit un effet exactement inverse. L’accession au pouvoir n’a pas levé le voile d’une supposée taqiyya (dissimulation) pour révéler la « vraie nature » des nouveaux maîtres de Damas ; elle les a enfermés dans un maillage de contraintes toujours plus dense. Ces contraintes émanent tout à la fois d’une société syrienne profondément plurielle, d’une communauté internationale attentive et intrusive, et des pesanteurs propres à l’historicité de l’État syrien lui-même. Dans ce contexte, loin d’opérer le passage attendu du tamkīn au taḥkīm, le pouvoir réaffirme la primauté du politique sur le religieux et prolonge, en la consolidant, la dynamique d’ajustement thermidorien amorcée à Idlib. La cohérence doctrinale du moment fondateur s’efface progressivement au profit d’une rationalité étatique qui subordonne le dogme aux impératifs de gouvernement.

En effet, la prise de l’appareil étatique transforme ainsi chaque principe en problème pratique : que faire de magistrats non musulmans ou de femmes juges déjà en fonction ? Comment exclure une femme d’un portefeuille ministériel sans provoquer de ruptures politiques et symboliques majeures ? Comment gouverner l’islam damascène, avec son clergé ancien, ses notabilités religieuses, ses équilibres locaux et ses traditions propres ? Comment prévenir les effets centrifuges d’un identitarisme sunnite poussé à l’excès, susceptible de marginaliser les minorités et de précipiter soit une fragmentation territoriale, soit l’instauration d’un régime fondé sur une coercition accrue, aux coûts élevés tant pour la stabilité interne que pour la position internationale du pouvoir ? Comment, enfin, exercer le pouvoir sans s’assurer l’adhésion — ou à tout le moins l’acceptation — des élites administratives et étatiques héritées du régime précédent ?
Loin d’ouvrir un espace de radicalisation par le haut, le tamkîn a donc opéré comme un puissant mécanisme de canalisation, contraignant le pouvoir à composer, arbitrer et renoncer, sous peine de rendre sa domination politiquement et socialement intenable. La déradicalisation continue, mais par raison d’État, si je puis dire. Par exemple, la création d’un conseil de fatwa au niveau national a été un exercice d’inclusion : intégrer des salafistes, des soufis, et différentes traditions damascènes, sans imposer une uniformisation doctrinale. La logique d’appui sur l’ordre religieux existant se poursuit : on institutionnalise ce qui est là, on accepte les pesanteurs du social désormais damascène, et on compose avec l’inertie cette fois de l’État. L’orientation retenue ne relève pas d’un projet salafiste de refondation idéologique autoritaire ; elle suscite en revanche, chez les puristes, la crainte récurrente d’un tamyīʿ, entendu comme l’affaiblissement normatif du dogme initial.
En même temps, il existe des pressions par le bas et des dynamiques de salafisation locale. Ici, ce sont des configurations territoriales, des héritages, des retours de commandants, des luttes de contrôle de mosquées. Et il faut tenir deux choses en même temps : au niveau national, une politique d’équilibrisme institutionnel ; au niveau local, des flux et reflux, parfois contradictoires, selon les rapports de force sur le terrain.
La mutation la plus importante, à mes yeux, concerne la nature même de la radicalité après la prise de Damas. À Idlib, la radicalité était relativement identifiable : une idéologie (salafiste-jihadiste), des organisations (Daesh, al-Qaïda, Hurras al-Dîn, etc.) et des acteurs numériquement limités, repérables. C’était un radicalisme « périphérique » au sens sociologique : des marges nettement distinctes et limitées en nombre. À ce titre, elle pouvait faire l’objet d’une approche principalement sécuritaire — ce que HTS fit. Après la prise de Damas, on observe une migration de la radicalité vers le centre. La radicalité n’est plus uniquement le produit d’organisations extrémistes constituées. Elle devient, dans une partie du courant dominant sunnite, une radicalité identitaire, ethno-confessionnelle — que l’on peut décrire, si l’on cherche un terme, comme un « suprémacisme sunnite ». L’idée diffuse — parfois implicite, parfois explicite — qu’après la guerre, « le pouvoir, on va le garder », et que ceux qui ne font pas partie du nouveau groupe dominant devront s’y plier. Cela fabrique une hiérarchisation confessionnelle de facto, et peut justifier divers régimes de violence : refoulements communautaires, pressions, humiliations, expulsions, et dynamiques revanchistes tribales.
Cette radicalité extrême-centriste n’est pas idéologisée au sens classique. Elle n’est ni salafiste ni jihadiste, même si elle se nourrit ponctuellement des appels au jihad dans certaines conjonctures. C’est un populisme de revanche, alimenté par la mémoire de la guerre, et par une disposition à la violence acquise dans la longue durée du conflit. Face à cela, le régime est embarrassé : sur le plan international, cette violence abîme l’image et complique la reconnaissance ; sur le plan interne, elle rend plus difficile la construction d’ententes avec des groupes situés hors du mainstream sunnite. Enfin, sur le plan sécuritaire, ce n’est plus une menace identifiable et limitée, mais un climat social diffus, parfois soutenu par des solidarités horizontales, tribales, locales — des logiques de fazʿa — fortement génératrices de violences comme on a pu le voir sur le littoral syrien en mars et dans le Sud en juillet 2025. Et paradoxalement, dans des moments de fragilité, le pouvoir peut être tenté de s’appuyer sur ces dynamiques de revanche pour faire pression sur des groupes rétifs. Ce qui nourrit un cycle de violences.
En somme, on passe d’un radicalisme « doctrinal et organisationnel » à un radicalisme « social et identitaire » qui ne peut faire l’objet d’un traitement purement sécuritaire. Et cela, si l’on prend du recul historique, s’inscrit dans une vieille question régionale : la transformation de sociétés impériales en États-nations capturés par des groupes confessionnels, produisant des États faibles, des sociétés fragmentées, et des ingérences étrangères. Il est trop tôt pour conclure définitivement sur la Syrie. L’identitarisme est, pour l’instant, davantage un produit social post-conflit en situation d’incertitude identitaire qu’un ordre institutionnel pleinement cristallisé. Mais la trajectoire est inquiétante, et elle oblige à repenser ce que nous appelons « radicalité » : non plus seulement comme idéologie marginale, mais comme possibilité de violence depuis le centre. Toutefois, la Syrie reste ce qu’elle a toujours été : balad al-ʿajāʾib, le pays des surprises. Elle peut encore nous surprendre — pour le pire parfois, mais également, souvent, pour le meilleur.
Patrick Haenni est chercheur en sciences sociales, spécialisé dans l’étude des mouvements sociaux et des processus de formation étatique au Moyen-Orient. Titulaire d’un doctorat en science politique de l’Institut d’études politiques de Paris, il a travaillé successivement avec le CNRS au Caire, l’International Crisis Group au Liban, ainsi qu’à l’Institut universitaire européen de Florence.